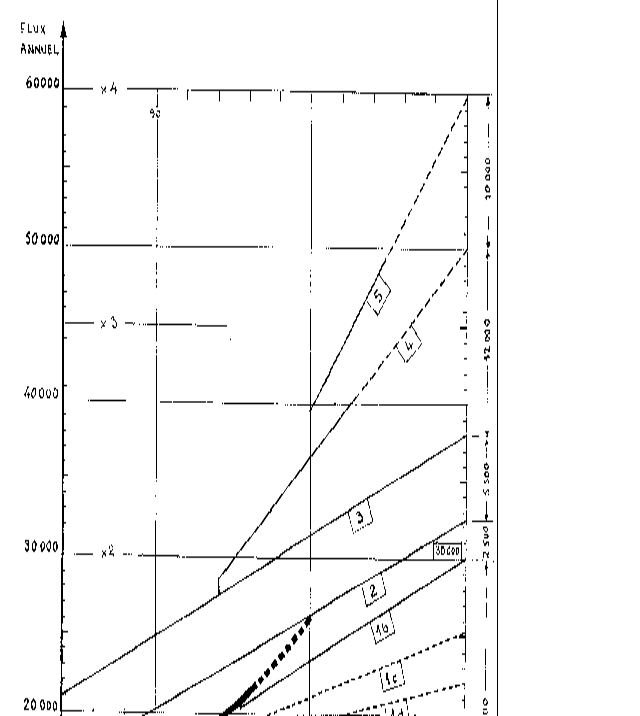
La présente note a été rédigée avec le souci de fournir des points de repère à tous ceux qui ont à traiter de formation et de flux dans les écoles d'ingénieurs.
CAF= Coefficient d'augmentation des flux
FLUX DE SORTIE 2000
= ---------------------------------------------------
FLUX DE SORTIE 1987
Pour les comparaisons avec les pays industrialisés il convient aussi de connaître les flux :
et depuis peu
Pour ces différentes formations, l'évolution des flux envisagés pour ces prochaines années a fait et fait encore l'objet de nombreuses déclarations.
La présente note sur l'évolution des flux à terme essaie d'établir une synthèse des actions en cours. Il est évident que d'aucuns mettent en cause la faisabilité de tel ou tel programme Il n'a pas été tenu compte de ces commentaires, car il est difficile de mettre en doute la parole du Président de la République et de ses Ministres.
Il appartient à chacun de corriger, conforter ou minorer en fonction de ce qu'il sait ou de ses capacités à intervenir dans le déroulement du processus en cours.
Depuis plusieurs décennies le doublement des flux s'effectue sur une période de 16 à 17 ans (+ 4,2 % par an). Depuis 1988/90 a été affichée une volonté de doublement plus rapide sur la base de départ de 15 000 en 1987.
Du fait de la durée des études la réponse du système est de 3 à 4 ans. De plus la montée en puissance s'étale généralement sur 3 ans. Ainsi pour une habilitation pour un flux de 100, la première promotion sera de 50, la seconde de 75 et la troisième de 100.
Pour les écoles classiques nous enregistrons une élévation du taux de croissance dès 1990. A partir de 1992 l'accroissement sera très significatif. Sous réserve des collationnements définitifs les valeurs suivantes peuvent être retenues
1989 : + 4,2 % 1990 : + 5 1991 : + 7 1992 : + 8 à 10
En 1991 les habilitations CTI ont été très importantes, pour les écoles classiques :
Ecoles nouvelles : 19 Flux supplémentaires : 2 500
A ces chiffres il convient d'ajouter les habilitations relatives aux Nouvelles Formations d'Ingénieurs
Habilitations : 40 Flux en régime de croisière : 2 000On trouvera en annexe 1 et 2 des détails relatifs à ces chiffres. Il convient de noter que le chiffre des flux supplémentaires n'est pas complet. Dans les écoles existantes des augmentations de faible importance relative ou résultant d'une politique générale, ne font pas forcément l'objet d'un examen par la CTI. Ces dernières augmentations très disséminées sont en fait d'importance non négligeable dans le contexte actuel. Par ailleurs, en période de croissance, et surtout de croissance forte, les départs en retraite sont inférieurs aux flux des jeunes promotions de diplômés. Ainsi, sauf circonstance exceptionnelle, il y a renforcement de l'apport net en ingénieurs diplômés arrivant sur le marché du travail.
Nous adoptons ici l'hypothèse basse, soit 30 000 en l'an 2000.
Voir en annexe 3 un examen rapide des différents groupes d'écoles et des différentes spécialités.
Si sur le plan national on peut les oublier, il ne peut en être de même dans le cas d'une comparaison avec l'étranger.
Le flux 1987 pouvait être estimé voisin de 1 500. Nous admettons un accroissement jusqu'à 2 500, mais nous ne disposons pas d'information précise pour étayer ce chiffre. Nous l'avons volontairement limité faute d'éléments suffisants sur ces écoles et aussi parce que, notoriété acquise, elles se font habiliter et concourent alors au développement des écoles classiques.
Citons par exemple : en 1990, habilitation de l'Ecole Centrale d'Electronique (ECE), ex Ecole Centrale de TSF, fondée en 1919. En 1991, habilitation de l'ESIGETEL (Avon Fontainebleau).
Différents rapports à caractère officiel estiment le flux "ingénieurs + gradués universitaires équivalent", entre 20 000 et 25 000 par an, pour la période 1987/89, en excluant les maîtrises purement scientifiques et en ne prenant pas en compte les écoles d'ingénieurs non habilitées CTI.
Dans le graphique récapitulatif nous retiendrons un flux évoluant de 4 500 à 5 500. Il faut en effet tenir compte des transformations de MST en écoles d'ingénieurs.
A terme, quel sera l'avenir de ces formations ? trouveront elles encore leur place dans le maelström en cours d'évolution ?
Les flux de croisière qui en résulteront seront de :
L'objectif affiché et encore récemment rappelé est un flux de 15 000 ingénieurs en l'an 2000. Compte tenu du temps de réponse du système et de sa montée en puissance, il faudrait donc accélérer les créations pour atteindre l'objectif. Si l'on se réfère aux personnes les plus autorisées en la matière, il apparaît que le chiffre de 15 000 ne sera très probablement pas atteint. Nous retiendrons le flux de 12 000 en 2000. Peut être que ce chiffre est encore trop élevé ?
Si au flux des écoles classiques nous ajoutons le flux des NFI, le doublement (30 000) sera atteint dès 1995/96.
Dans la filière ingénierie, le Ministère de l'Education Nationale prévoit d'ici à 2000 la sortie d'un flux annuel de 10 000 ingénieurs-maîtres.
Etant donné l'annonce très officielle de ce flux, c'est celui retenu dans le diagramme ci après.
Ces formations ne sont pas prises en compte dans les flux de la présente note. Toutefois en fonction des évolutions il n'est pas impossible qu'en l'an 2000 il ne faille pas tenir compte de certaines de ces formations.
L'évolution de référence est celle du doublement. C'est à dire un flux de 15 000 en 1987 pour les écoles classiques et un flux de 30 000 en l'an 2000. Cette courbe d'évolution de référence correspond déjà en fait à l'évolution proprement dite des écoles classiques.
Pour les écoles classiques figurent deux autres courbes + 3 % et + 4,2 % par an et une courbe en trait gras qui représente ce qui est acquis et très probable pour les très prochaines
Au dessus de la courbe de référence s'ajoutent successivement : les écoles non habilitées CTI, les formations universitaires, les NFI, les IUP.
Le point objectif sur la projection se situe à 60 000 en l'an 2000. Si ce niveau est atteint, il y aura certainement des modifications dans les composantes.
Ce point atteint par le courbe enveloppe peut paraître élevé. Il est cependant corroboré par la déclaration de M. Lionel JOSPIN au Conseil des Ministres du 12 février dernier. A l'horizon 1996/97 le point atteint par la courbe enveloppe correspond aux prévisions ministérielles.
D'aucuns diront aussi qu'il faut distinguer entre l'ambition et le possible. Le réel est conditionné par le vivier des candidats et les moyens pouvant être mis en oeuvre tant sur le plan des enseignants que des locaux et des équipements. Pour ces critères dont il est difficile de mesurer l'impact nous avons pointillé l'aboutissement des courbes 4 et 5.
Comme indiqué dans le préambule il appartient à chacun d'interpréter et de corriger en fonction de ses informations. On peut certes objecter qu'il y a des doubles diplômes. Ces doubles diplômes existent aussi à l'étranger. De plus, étant donné le niveau de flux que nous atteindrons, la correction n'aurait plus grand sens.